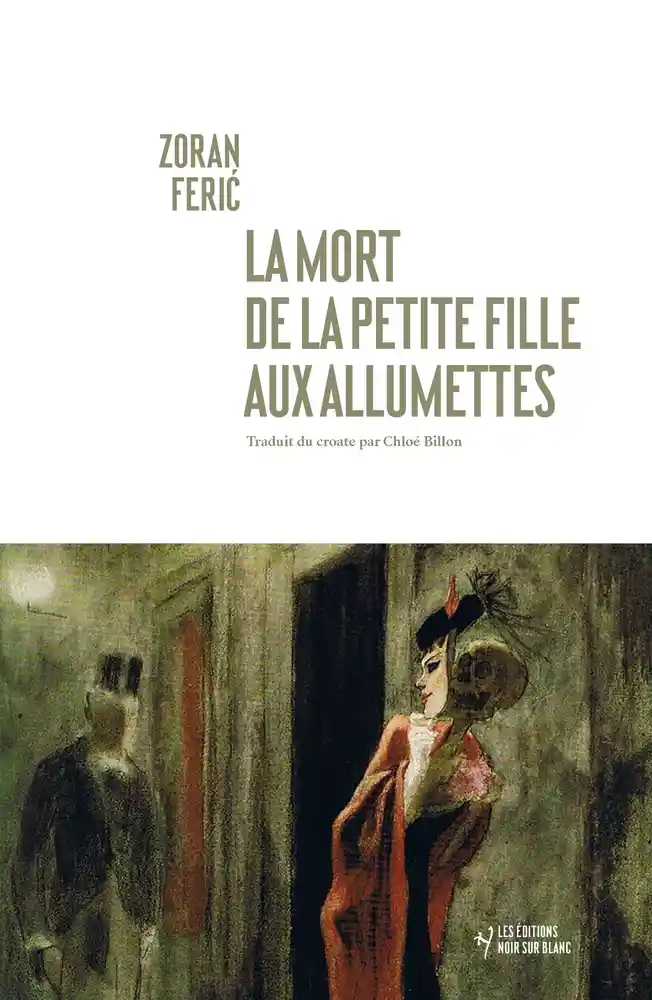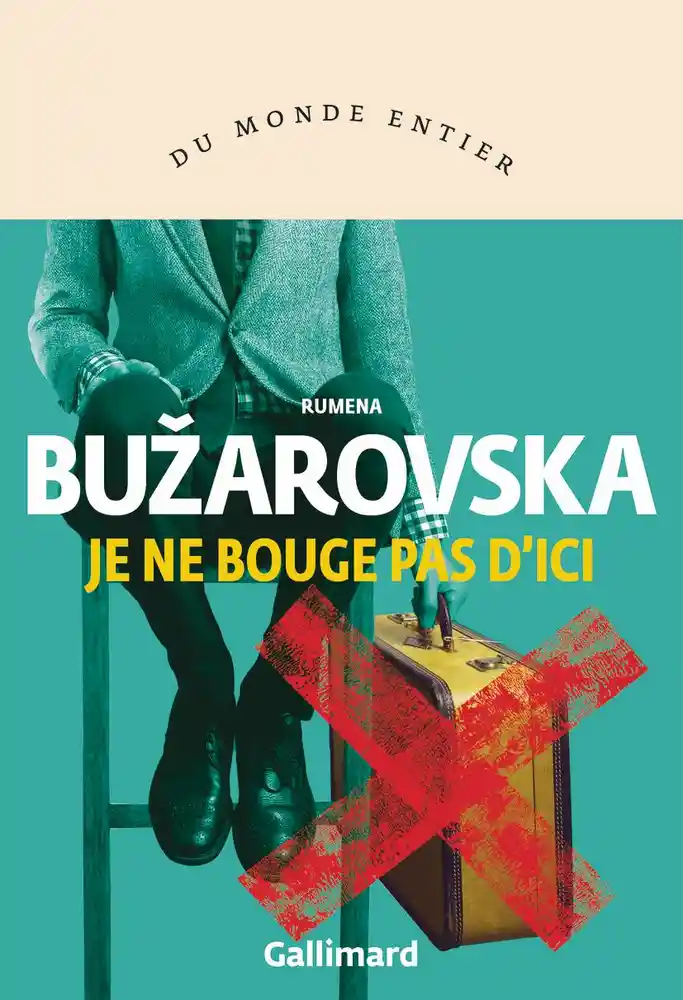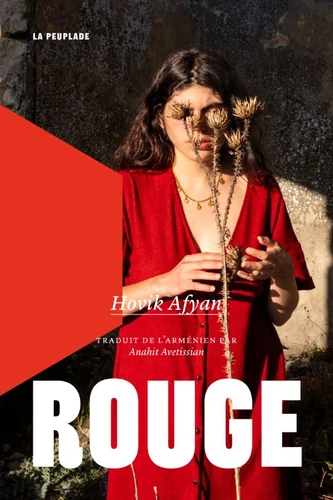Europe centrale et orientale
Dans l'intimité d'une Ukrainienne (Dans leur dos)
Publié en 2019, le roman de Haska Shyyan, Dans leur dos, a suscité un vif débat en Ukraine, comme l'explique Andreï Kourkov dans sa préface. Ses détracteurs ont notamment reproché à l’autrice d’avoir choisi une anti héroïne en guise de protagoniste : sa Marta de vingt-sept ans, égocentrique et étrangère à tout sentiment patriotique. C'est le portrait et le quotidien d'une jeune femme qui, dans les premiers temps, fait pourtant le maximum pour épouser la conscience collective, alors que son fiancé vient de s'engager et de partir sur le front du Donbass. Ce n'est pas qu'elle est insensible à l'invasion russe à l'est de l'Ukraine mais elle a du mal avec les injonctions sociales et se sent loin de la guerre, tandis qu'elle pressent que son couple ne survivra pas à l'éloignement. La plus grande partie des 3/4 du livre relate avec minutie les états d'âme de Marta, de 2014 à 2016, dans une vie qu'elle ressent comme de plus en plus étouffante. Un séjour organisé en France, qui relance un récit dont l'étreinte est parfois suffocante et qui ressemble davantage à un journal intime qu'à un roman, va lui permettre de fuir la chape de plomb qui l'asphyxie, la libérant jusqu'à un événement particulièrement tragique. Comme le précise encore Andreï Kourkov : "Dans leur dos ne se cantonne pas aux thèmes de la guerre, de la neutralité et de la fuite. Dans l’éventail très large des thèmes abordés par l’autrice, on remarque tout particulièrement ceux du corps et de la sexualité féminins."
L'auteure :
Haska Shyyan est née le 23 juillet 1980 à Lviv (Ukraine). Elle a publié 2 livres.
Comment peut-on être Letton ? (Tigre)
Après Metal, réjouissant roman, voici Jānis Joņevs sur le format court, avec son recueil de nouvelles, Tigre, dont la couverture représente un chat, détournement à la Magritte qui illustre parfaitement le goût de l'auteur pour l'insolite et l'absurde. Tigre lui permet de laisser libre court à sa créativité dans des récits dont la logique nous échappe souvent, si ce n'est celle de l'irréalité qui tutoie à l'occasion le fantastique. Mais la constante de ces 12 nouvelles, outre un humour très particulier, est leur imprévisibilité, dans des situations très diverses où le hasard et la nécessité se mêlent dans une réflexion existentielle, qui peut paraître digressive et qui ne l'est pas tant que cela. Le pays natal de l'auteur est souvent moqué, de manière acide ou plus légère, ainsi que ses habitants sans qualités majeures, au point que le livre aurait pu s'intituler : comment peut-on être Letton ? Les nouvelles ont beau sembler disparates, elles composent somme toute un ensemble cohérent, un peu comme du Kafka "Light", qui installent définitivement Jānis Joņevs comme un écrivain singulier dont il ne sera pas désagréable de découvrir les prochaines livraisons à l'avenir.
L'auteur :
Jānis Joņevs est né le 21 mars 1980 à Jelgava (Lettonie). Il a publié 4 livres dont Metal.
Les contes sont bons (Le loup bouilli)
En 2013, paraissait aux éditions Le Tripode un roman intitulé L'homme qui savait la langue des serpents, d'un auteur estonien inconnu, Andrus Kivirähk. Un récit sublime, empli de réalisme magique, d'absurde et de grotesque, serti d'un humour irrésistible. Comme une sorte d'Arto Paasilinna balte, mais avec un aspect fantastique plus marqué. Trois nouvelles traductions ont suivi, confirmant le talent de cet auteur prolifique, dont la dernière en date date désormais de 2020. Et à ce jour, ces trois derniers romans sont toujours inédits en langue française (ceci est un appel du pied très pressant au Tripode !). Quelle bonne surprise tout de même que l'arrivée en librairie de Le loup bouilli, un petit ouvrage bilingue, publié par L'Asiathèque et constitué de 5 textes. L'occasion de savourer la maestria de Kivirähk sur le format court, avec la suite, à sa sauce particulière, de contes célèbres qui évoquent notamment les trois petits cochons, Pinocchio et la reine des Neiges. Un véritable délice de gourmet qui ne frustre que par sa brièveté. Inutile de préciser que l'on espère du très consistant dans un proche avenir pour rassasier notre appétit d'ogre vis-à-vis de l’œuvre du natif de Tallinn.
L'auteur :
Andrus Kivirähk est né le 17 août 1970 à Tallinn. Il a publié une quarantaine de livres dont L'homme qui savait la langue des serpents, Les groseilles de novembre et Le Papillon.
Est-ce ainsi que les Russes vivent ? (Sentiments offensés)
Alissa Ganieva a quitté la Russie en 2022, après le début de la guerre en Ukraine. Le plus étonnant est qu'elle ne l'ait pas fait auparavant, eu égard à l'explosivité de son roman Sentiments offensés, paru initialement en 2018, et seulement en 2025, dans sa traduction française. La montagne du festin, son livre précédent, était peu enthousiasmant, dystopie confuse qui se déroulait dans son Daghestan natal. Sa nouvelle publication est d'une toute autre trempe, faux polar qui se veut surtout une satire noire de la vie provinciale en Russie, notamment du côté de ceux qui ont un certain pouvoir. La plume est féroce et aucun personnage, dans ce roman choral, ne ressort intact. La corruption est partout, à peine dissimulée, et la morale n'existe pas dans une région censée symboliser la Russie toute entière, avec son népotisme, ses délations et son obéissance obligée aux directives de Moscou. Le climat est anxiogène, tout le monde épie ses voisins et se doit de se montrer patriote, en ironisant sur le monde occidental, en vilipendant le voisin ukrainien et en faisant le plus souvent référence (et révérence) à la glorieuse histoire nationale, y compris la période soviétique. Le livre est drôle, parfois, s'égare dans de drôles de scènes, un peu, mais c'est surtout une sourde angoisse qui, au fond, nous étreint. Est-ce ainsi que le peuple russe vit, condamné, comme au temps des tsars, à baisser la tête et à tenter de survivre, pour le quidam moyen, et à prospérer toute honte bue, dans les compromissions, pour les élites ?
L'auteure :
Alissa Ganieva est née le 23 septembre 1985 à Moscou. Elle a publié 5 livres dont La montagne du festin.
Evanouie dans la nature (La Fleuriste)
Les thrillers aussi permettent de voyager, et pas seulement en Scandinavie ou aux États-Unis. Par exemple en Europe de l'Est, avec Arpad Soltesz, un "méchant" auteur slovaque qui décrit à merveille les dérives et les corruptions de son pays. Pas loin, mais dans un autre registre, moins politico-social, Alicja Sinicka est présentée comme "la reine polonaise incontestée du thriller psychologique et domestique." C'est suffisamment alléchant pour voir de quoi il retourne, avec la publication d'un premier roman en français, La Fleuriste. Avec ses deux protagonistes/narrateurs, l'un, le mari de la commerçante disparue et l'autre, la meilleure amie de la susdite, la confiance ne règne pas avec leurs récits qui semblent dissimuler chacun des secrets plus ou moins enfouis. L'autrice ne lésine pas sur les rebondissements d'une enquête qui progresse moins par l'action de la police que par la succession de découvertes des deux personnages cités plus haut, mais également par leur passé commun avec la femme évanouie dans la nature. Si le livre remplit sa fonction, en termes de suspense et de surprises, l'écriture d'Alicja Sinicka se révèle assez plate, avec notamment des dialogues pas très convaincants. La faute à la traduction ? Ou alors, le choix de la simplicité par la romancière qui aurait pu (dû ?) épicer un peu son style pour rejoindre le caractère tourmenté de son héroïne, une absente à la très forte présence. Bilan un peu mitigé, en définitive, mais qui n'entame pas la curiosité pour cette autrice jeune (37 ans) et prolifique.
Merci à NetGalley et aux éditions Mera.
L'auteure :
Alicja Sinicka est née le 15 avril 1987 en Pologne.
Et au milieu coule la Bosna (A la fin de l'été)
Grâce à de jeunes maisons d'édition, notamment, la riche littérature des pays de l'ex-Yougaslavie nous parvient de plus en plus régulièrement et qu'importe si les œuvres ont mis, parfois, plusieurs années à franchir les frontières. Ainsi en est-il du premier roman de la native de Bosnie, Magdalena Blažević, traduit par Chloé Billon pour le compte des formidables éditions Bleu et Jaune. A la fin de l'été se déroule avant et pendant la guerre, dans un petit village, proche de la rivière Bosna, qui semble à l'abri du conflit. Pourtant, la mort va frapper une fille de 14 ans, innocente, qui raconte elle-même, voix d'outre-tombe, les circonstances de la tragédie mais aussi, auparavant, sa vie insouciante, au milieu de la nature généreuse, auprès de sa famille et d'un environnement tranquille. Un roman à hauteur d'enfant et d'adolescente ? Oui, mais revisité par l'autrice car les mots employés et les images convoquées ne sont pas toujours ceux d'une fille de son âge. Il faut accepter cette licence littéraire qui évite le réalisme, à quelques passages près, pour une poésie sensorielle qui contraste d'autant plus avec la brutalité de l'irruption de la Camarde dans cet univers pacifique. Jamais Magdalena Blažević ne donne l'identité ni l'appartenance des bourreaux, ne reste que l'absurdité d'une mort gratuite, fruit de la haine et de l'inconscience des hommes. Le livre, qui se déroule en Bosnie, a reçu le Prix du meilleur roman croate en 2023 et une autre récompense qui porte le nom d'un écrivain serbe. Une sorte d'ironie pour un livre qui décrit, à sa manière distanciée et lyrique, le temps pas si lointain où ces trois communautés se déchiraient et se tuaient entre elles.
L'auteure :
Magdalena Blažević est née en 1982 en Bosnie.
La mort dans l'île (La mort de la petite fille aux allumettes)
Fantasmes et désollusions (Je ne bouge pas d'ici)
Sauf erreur, Rumena Bužarovska, que l'on a découverte en France, chez Gallimard, en 2022, avec son recueil de nouvelles Mon cher mari, n'a toujours pas écrit de roman. Ce qui est fort dommage, eu égard au potentiel que recèle chacune des histoires qu'elle nous offre dans sa nouvelle collection de nouvelles, intitulée Je ne bouge pas d'ici. Que ce soit à la première où à la troisième personne, les récits de l'autrice Nord-Macédonienne témoignent une fois encore de ses qualités dans le domaine de la raillerie, vis-à-vis de ses compatriotes, presque toujours des femmes, qu'elles habitent au pays ou soient expatriées, dans une contrée anglo-saxonne. Dans ces contes cruels, Rumena Bužarovska ne ménage personne, pas d'inquiétude, les hommes en prennent aussi pour leur grade, pointant du doigt la jalousie, la médiocrité, l'insatisfaction, la honte ou l'intolérance des unes et des autres, dans des situations embarrassantes de comparaisons de statut ou de confrontations. La nouvelliste ne craint pas les scènes à la limite du sordide, inconfortables autant pour les protagonistes que pour le lecteur, dont la seule défense est de rire jaune, s'il apprécie l'humour noir. La native de Skopje se surpasse dans sa dernière nouvelle, Le 8 mars - L'accordéon, un sommet d'humeur sardonique pour clouer au pilori la dégradation sociale de la Macédoine du Nord et les complexes et l'envie de ses habitants vis-à-vis de l'Amérique, qui reste terre de fantasmes, avant de devenir lieu de désillusions.
L'auteure :
Rumena Bužarovska est née en 1981 à Skopje (Macédoine du Nord). Elle a publié 4 recueils de nouvelles dont Mon cher mari.
Des guerres sans fin (Rouge)
A peine sortie de l'ère soviétique et fraîchement indépendante, l'Arménie a connu presque aussitôt une première guerre du Haut-Karabakh, contre l'Azerbaïdjan. La paix n'a jamais véritablement régné entre ces deux pays, toujours autour du territoire convoité, et un deuxième conflit a eu lieu en 2020, conclu par la victoire du gouvernement de Bakou, appuyé par les Turcs. Mais la tension reste permanente et l'apaisement ne semble pas proche. De ces guerres sans fin, Hovik Afyan fait son sujet dans Rouge, non sur le plan politique, mais sur ses aspects humains et ses dommages, directs et collatéraux, dans la population arménienne. Les chapitres de ce court roman alternent entre les deux époques et des personnages se croisent, parfois sans se connaître. Des hommes, des femmes, des enfants, tous sont victimes, tous sont brisés dans leurs élans et leurs espoirs. Il y a pourtant l'art, la danse et la peinture, pour deux des personnages principaux, mais ils ne sont pas suffisamment forts pour empêcher les destructions, physiques et mentales. Et l'amour ? Il est présent ou l'a été mais suffit-il pour servir de gilet pare-balles ? Pour dire l'horreur, la déréliction, la mort, la faim et quelques rares éclaircies passagères, l'auteur use d'une langue poétique sans afféteries. Cette voix d'une littérature arménienne que l'on connaît si peu, fait à la fois du mal et du bien car elle témoigne et, malgré tout, ne veut pas se résigner pas à la désolation.
L'auteur :
Hovik Afyan est né le 29 juillet 1983 à Abovyan (Arménie).
Les fissures de l'amont (La Rivière)
Les précieuses éditions Bleu et jaune nous offrent avec La Rivière un premier roman d'une autrice lettone, Laura Vinogradova, dont la brièveté et la simplicité de style servent une narration fluide, dont la douceur apparente décrit pourtant un personnage fissuré de partout. Dina, 37 ans, vit sans sa sœur disparue depuis 10 ans, et sans sa mère, dont on apprendra au milieu du livre où elle se trouve. Quant à son père, qu'elle n'a jamais connu, il vient de mourir et c'est dans sa maison, à la campagne, près d'une rivière, qu'elle vient panser ses blessures, certaines datant de l'enfance, et peut-être retrouver le goût de vivre. Cette femme qui recherche la solitude et se révèle méfiante vis-à-vis de ses prévenants voisins va t'elle baisser les armes, accepter enfin le deuil de sa sœur et se reconnecter aux autres ? Malgré ou à cause de ses phrases courtes, de sa précision dans la description des gestes du quotidien, de son élégie discrète d'une nature apaisante, La Rivière est une lecture dense et profonde qui sait aussi portraiturer ses personnages secondaires en quelques mots seulement et exhale les parfums de la détresse et de la mélancolie avec une certaine grâce. La romancière se révèle également, l'air de rien, capable de nous surprendre dans le cheminement de Ruta, laquelle, avare de ses mots, est une héroïne aussi insaisissable et faussement passive, qui a compris que sa guérison passait finalement par la bienveillance de ceux qui l'entourent et par sa propre acceptation d'une vie qui doit regarder vers l'aval plutôt que vers l'amont.
L'auteure :
Laura Vinogradova est née le 31 mai 1984 en Lettonie.