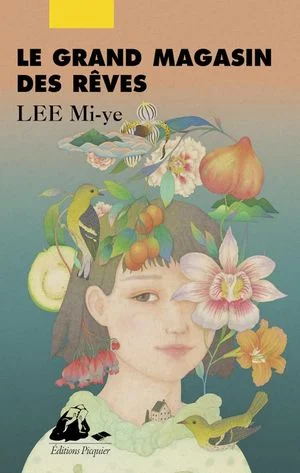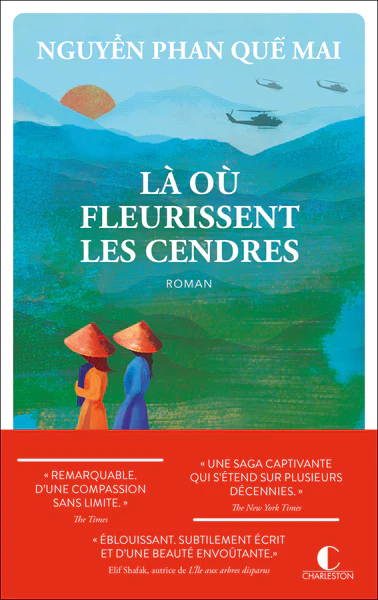Asie
Malaises en Malaisie (La maison des portes)
Il ne faut pas confondre les termes Malaisiens et Malais. Le premier désigne les habitants de Malaisie, quelles que soient leurs origines et le second un groupe ethnique qui constitue la plus grande communauté du pays mais qui est aussi présent à Singapour ou en Indonésie. Tan Twan Eng, l'auteur de La maison des portes, est bien malaisien mais issu de la communauté chinoise, laquelle est d'ailleurs aujourd'hui la plus importante (devant les Malais) sur l'île de Penang, dans laquelle se déroule la plus grande partie de l'intrigue du livre. Mais c'est d'un temps plus ancien dont nous parle l'auteur, celui de l'Empire colonial britannique, en 1921, principalement, mais aussi 11 ans plus tôt. Dans ce récit historique, Tan Twan Eng mélange avec une grande dextérité et une élégance de style, qui se laisse aller tout de même vers une certaine mièvrerie, parfois, la fiction et certains faits avérés, notamment autour d'un meurtre qui a choqué la colonie, mais aussi de personnages qui ont réellement séjourné dans ce qu'on appelait alors les Établissements des Détroits, à savoir le révolutionnaire chinois Sun Yat-sen (qui a la particularité d'être de nos jours aussi bien célébré en Chine qu'à Taïwan) mais surtout l'écrivain Somerset Maugham, celui là-même dont Souchon évoquait les "nouvelles pour dames", ce qui montre que le chanteur n'avait pas dû beaucoup lire les susdites qui, certes, peuvent paraître désuètes, mais dont l'acuité et la cruauté mériteraient de faire sortir l'écrivain de l'oubli, voire du dédain, desquels il est désormais victime. Mais foin de digressions, et avouons que La maison des portes est le plus souvent passionnant à lire, entre exotisme et nostalgie, mais aussi pour l'acidité narquoise portée sur les mœurs des colons britanniques, avec leur hypocrisie, leur mépris pour les autochtones et leurs secrets inavouables, qu'ils aient trait aux adultères ou à l'homosexualité, entre autres. La plume de l'auteur, sans chercher à copier celle de Maugham, lui ressemble cependant, tant dans la description des turpitudes humaines que dans celle des paysages émollients d'Asie. C'est un voyage géographique et historique dans lequel il n'est pas inutile de se prélasser benoîtement. Malaises en Malaisie, par conséquent, mais pas uniquement.
L'auteur :
Tan Twan Eng est né en 1972 à Penang (Malaisie). Il a publié 3 livres.
12 ans de stérilité (Femme pour moitié)
Les amateurs de littérature indienne ont l'habitude de grandes sagas, souvent familiales, traduites de l'anglais, avec des auteurs aussi célèbres mondialement que Ghosh, Seth, Roy, Adiga, etc. Perumal Murugan est différent : il écrit en tamoul, sa langue natale, et Femme pour moitié est davantage une chronique, ou mieux encore un conte, situé dans le Tamil Nadu, au sud-ouest de l'Inde, autour d'un couple de paysans heureux en amour mais dont le grand drame est de ne pas avoir d'enfants, après 12 ans de vie commune. Le romancier décrit avec vivacité cette situation qui suscite plaisanteries, quolibets, remarques et condescendance, dans leur famille, leur village et au-delà. Murugan est doué comme satiriste et sa plume est trempée dans une ironie mordante qui n'épargne ni la religion ni les traditions ni le virilisme ambiant. Un récit en partie "pittoresque" pour des lecteurs occidentaux mais parfaitement ancré dans un pays où la violence n'est jamais loin et la fin du livre, suspendue, tranche par son annonce tragique. Il est nécessaire de lire la préface de Laetitia Zecchini, l'une des traductrices du roman, qui explique comment des groupes hindous radicaux ainsi que des groupes fondés sur les castes ont exigé des mesures violentes contre l'auteur, qui, à leurs yeux, avait brisé les barrières morales, insulté les dieux et répandu des mensonges sur leur communauté. Si la justice a donné raison à Murugan, qui a un temps arrêté d'écrire, celui-ci a reconsidéré son œuvre et s'est appliqué désormais à pratiquer une forme d'auto-censure. Tout cela pour avoir évoqué clairement une pratique avérée mais hypocritement dissimulée, dans Femme pour moitié.
L'auteur :
Perumal Murugan est né le 13 octobre 1966 à Tiruchengode (Inde). Il a publié une trentaine de livres dont Le Bûcher.
Tremblements de l'âme (Le fil de l'espoir)
Keigo Higashino ose tout et c'est à cela que l'on reconnaît le romancier japonais, capable, dans Le fil de l'espoir, d'infuser une très généreuse dose de mélodrame dans le polar qu'il est censé dérouler. Après un prologue où un tremblement de terre plonge des parents dans l'affliction, ce sont des tremblements de l'âme que va enregistrer le sismographe nippon, autour des destins de plusieurs personnages, rattrapés par le passé et leur vraie/fausse ascendance ou descendance. Il y a bien un meurtre, celui d'une vieille dame propriétaire d'un salon de thé et une enquête qui suit mais c'est aussi, et peut-être surtout, l'humanité de l'ensemble des protagonistes, y compris le policier principal, qui va être singulièrement chahutée, au gré des révélations successives. Certes, la résolution de l'affaire va avancer et aboutir mais après quelques embardées et son progrès ne vient pas toujours de la police car Higashino nous livre à jets continus les pensées des personnes impliquées dans le crime. Les histoires de famille y sont complexes, marquées par la dissimulation, et se superposent avec une assez grande fluidité à l'enquête. Ce que l'on apprécie dans ce roman, c'est cette attention prodiguée à ses différents protagonistes, tous impactés, d'une manière ou d'une autre, par un secret qui fait évoluer leur itinéraire de vie mais aussi leur identité. Le fil de l'espoir est constitué d'un maillage de trames d'une densité extrême qui n'empêche pas l'auteur d'arriver sereinement au bout de son ouvrage avec la sérénité de celui qui a réussi à combiner suspense et sensibilité, en un dosage quasi parfait.
L'auteur :
Keigo Higashino est né le 4 février 1958 à Osaka. Il a publié près d'une centaine de libres dont La prophétie de l'abeille, Les miracles du bazar Namiya et Les sept divinités du bonheur.
Thé et empathie (Lettres d'amour de Kamakura)
Comme souvent dans une trilogie, et La papeterie Tsubaki ne fait pas exception à la règle, le meilleur ouvrage est le premier, sans doute parce que l'effet de nouveauté et, éventuellement, d'émerveillement, joue à plein. Ceci posé, Lettres d'amour de Kamakura, dans une ambiance qui nous est désormais familière, est loin d'être une déception. C'est un aspect particulier du Japon que Ito Ogawa décrit dans ses trois romans, traditionnel et assez attendu, par son exotisme, pour des yeux occidentaux. Ce n'est pas que ce Japon n'existe pas mais c'est une des nombreuses facettes d'un pays difficile à comprendre pour les étrangers, même après l'avoir visité. Il n'est besoin que de se balader dans la littérature nippone pour se rendre rendre compte de la complexité de la société et de la vision qu'en ont ses propres ressortissants, à commencer par une autre Ogawa, Yôko, qui se situe aux antipodes d'Ito. Sans parler du cinéma japonais qui de Naruse à Kurosawa, en passant par Masumura, Oshima et, plus récemment, Kore Eda et Hamaguchi, se conjugue sur des tonalités très diverses. Quoiqu'il en soit, Lettres d'amour de Kamakura, avec l'art d’accommoder les mots de son héroïne, papetière et écrivain public, appartient au registre de la bienveillance dans une philosophie de vie consciente de sa durée éphémère, qui encourage à profiter de l'existence et de rechercher l'harmonie à travers la famille, l'amitié, l'amour, la nature, la gastronomie, etc. L'altruisme et la compréhension des autres est au cœur du roman, avec pour ingrédients majeurs thé et empathie. Certes, tout n'est pas facile dans un monde où les contrariétés, les deuils et la tristesse s'invitent parfois mais ce n'est pas une raison pour ressentir stupeur et tremblements. Ito Ogawa n'est pas une autrice pour les cyniques ni pour les pessimistes mais quel mal y a t-il à cela, eu égard à l'apaisement que l'on ressent après la lecture de ses livres ? Vous reprendrez bien une tasse de thé ?
L'auteure :
Ito Ogawa est née en 1973 à Yamagata (Japon). Elle a publié 6 livres en français dont Le restaurant de l'amour retrouvé et La papeterie Tsabuki.
De familiers univers parallèles (La cité aux murs incertains)
Combien fûmes-nous, en 1990, à découvrir La course au mouton sauvage, la première traduction française d'un auteur japonais, alors inconnu, autant étrange que pénétrant ? L'eau a coulé sous les ponts, depuis, et le succès de Haruki Murakami n'a fait que s'amplifier, au fil des années. Aujourd'hui, La cité aux murs incertains recycle des éléments d'un roman précédent (La fin des temps), le sujet central remontant, lui, aux premiers écrits de Murakami. Le livre n'est donc pas une création totalement nouvelle mais de toutes manières ses thèmes et son style appartiennent sans conteste à ce qui nous est familier depuis bien longtemps. Objectivement, La cité aux murs incertains ne possède pas la grâce et l'éclat de certains de ses prédécesseurs, à commencer par Kafka sur le rivage ou 1Q84, entre autres, et la progression du récit semble parfois laborieuse avec ses deux univers (parallèles ?), l'un qui semble appartenir à la réalité et l'autre au rêve, mais rien n'est moins sûr, évidemment, chez l'auteur japonais. Lui dont on loue l'imaginaire et la beauté du bizarre semble ici paradoxalement plus à l'aise, et souvent bien plus passionnant, dans la description de la monotonie des jours d'un responsable de bibliothèque, solitaire mais tout de même confronté à une certaine part de surnaturel, cela va sans dire. Pour les vieux habitués et admirateurs de Murakami, faire la fine bouche devant son dernier ouvrage ne signifiera pas qu'ils ne l'ont pas dévoré à grandes lampées mais simplement qu'ils auraient voulu, mais n'ont pas réussi, à y retrouver l'intensité des plaisirs passés.
L'auteur :
Haruki Murakami est né le 12 janvier 1949 à Kyoto. Il a publié 15 romans dont La ballade de l'impossible, Kafka sur le rivage, 1Q84 et Le meurtre du Commandeur.
Alors, on danse ? (Le bal des sirènes)
Décédée en 2018, à moins de 50 ans, Li Wei Jing n'aura pas vu la parution de son dernier roman, Le bal des sirènes, à Taïwan. 5 ans plus tard, sa traduction française permet de découvrir ce livre posthume, le plus ambitieux qu'elle ait écrit, d'après ceux qui connaissent son œuvre. Le livre se concentre sur une femme d'âge moyen dont la passion est la danse de salon, tendance latine, avec la quête d'un partenaire pour pouvoir se perfectionner, sans pour autant viser la compétition. Dans ce monde très codifié, où "l'homme conduit et la femme suit", l'héroïne du livre redécouvre la maîtrise de son corps, avec lequel elle entretient des relations difficiles depuis l'enfance. Le ton mélancolique du roman (testamentaire ?) n'offre pas de scènes spectaculaires mais une progression agréable à suivre, avec quelques flashbacks à la clé, et une vision originale de la société taïwanaise dans laquelle danser a été une activité interdite, durant les longues années de dictature. Au côté du personnage principal, d'autres figures apparaissent et disparaissent (son mentor) dans un roman d'apprentissage tardif, dont le charme opère au fil des pages. Alors, on danse ?
L'auteure :
Li Wei Jing est née le 20 août 1969 et décédée le 13 novembre 2018 à Taipei.
Malin comme un songe (Le grand magasin des rêves)
Le domaine des rêves est un territoire personnel, intime, mystérieux, magique ou terrifiant, selon les cas. Dans Le grand magasin des rêves, Lee Mi-ye en imagine le commerce auprès de dormeurs qui préfèrent donc le préfabriqué à l'inconnu. Comme cette idée est étrange ! L'introduction à cet univers se fait de manière classique, via une nouvelle employée qui sera nos yeux dans la découverte de ce magasin où les clients se présentent en pyjama, puisque ils sont en plein sommeil. Chaque chapitre se déroule avec ce personnage de l'ingénue novice, son brillant patron et des employés plus ou moins fantasques, mais les situations diffèrent et semblent chacune caractériser des types de rêve différents, y compris pour nos amies les bêtes ou même des cauchemars. Tout cela est bien gentil, au bord de la niaiserie quand même, mais l'exploitation des rêves et donc des sentiments des "clients", cela ressemble à une affaire lucrative et pas très morale, même si l'autrice enrobe le tout dans des échappatoires supposées poétiques. Le roman aurait cependant pu être ludique si le style n'était pas aussi désespérément plat et si Lee Mi-ye avait construit une intrigue digne de ce nom et donné de l'étoffe à ses personnages. Désolé, le livre se veut malin comme un songe mais les rêves ne s'achèteront jamais en magasin.
L'auteure :
Lee Mi-ye est née en 1990 à Busan (Corée du Sud).
Sri Lanka nous était conté (Les sept lunes de Maali Almeida)
Il y a eu des livres d'écrivains sri-lankais, qui ont reçu un accueil confidentiel, quand ils ont été traduits. Il y a eu Dheepan, Palme d'or à Cannes, le beau film de Jacques Audiard, autour d'un réfugié tamoul. Il y a eu 26 ans d'une guerre civile atroce dans l'ancien Ceylan, qui n'a pas vraiment attiré l'attention des médias occidentaux : trop longue, trop lointaine, trop complexe. Maintenant, il y a Les sept lunes de Maali Almeida, qui a valu à son auteur, Shehan Karunatilaka, d'obtenir le très prestigieux Booker Prize. En le recevant, celui-ci a remercié son éditeur d'avoir publié ce livre "bizarre, difficile, étrange." D'autres qualificatifs pourraient être ajoutés : dense, labyrinthique, inextricable, sombre, satirique, fantastique... Cette histoire d'un mort récent, stationné dans un entre-deux administratif, et qui a 7 jours pour découvrir qui l'a tué et pour quelles raisons, se déroule au plus fort de la guerre, que le héros du livre documente en tant que photographe. Il faut s'accrocher à la lecture de ces sept lunes, entre le monde fantastique des morts-conscients et le théâtre des vivants du Sri Lanka, tandis que les dernières heures de Maali Almeida nous sont progressivement dévoilées. Malgré ou à cause de son style ébouriffant, le livre est épuisant pour peu que l'on se détache de son intrigue à plusieurs têtes et que l'on n'arrive pas à suffisamment se passionner pour son héros très excessif. Les sept lunes de Maali Almeida appartient à cette catégorie de livres, assez rares, en définitive, dont on ne peut louer que la richesse et la virtuosité, mais qui, dans le même temps, peuvent susciter un grand attachement autant qu'un renoncement graduel, devant une telle accumulation d'horreurs, de sortilèges et de chaos.
L'auteur :
Shehan Karunatilaka est né en 1975 à Galle (Sri Lanka). Il a publié 4 livres.
Manques d'assurance (La maison noire)
La découverte récente d'un romancier japonais aussi fou que Yûsuke Kishi, avec la publication de La leçon du mal, fut un plaisir innommable pour les lecteurs français, du moins ceux qui goûtent une certaine perversité, gorgée d'humour très noir, dans un suspense étouffant. Les éditions Belfond ont eu la bonne idée de poursuivre avec ce romancier dingue, en traduisant La maison noire, livre paru en 1997, au Japon. Le choc n'est pas le même qu'avec son roman précédent -on s'habitue à tout, même aux scénarios horribles-, mais l'on y retrouve la puissance d'évocation de Kishi, dans un engrenage imperturbable au cœur du mal, une fois encore. Rien de tel qu'un type normal, employé zélé d'une compagnie d'assurances, qui va perdre beaucoup ... de son assurance, devant un fraudeur (son identité sera révélée au moment opportun) prêt à tout et en priorité au pire. D'où la descente aux enfers qui se met en place lentement, avec la maîtrise très froide d'un auteur qui sait comment faire monter la tension et l'horreur. La lecture de la biographie de Yûsuke Kishi nous apprend qu'avant de devenir écrivain, il a travaillé dans le monde des assurances, ce qui explique la documentation très précise qui enrichit l'intrigue et la rend crédible, même si le bouchon est poussé très loin, afin de nous faire frissonner. Au passage, l'aspect très visuel du livre en ferait un candidat très prometteur pour une adaptation cinématographique, si cela n'a pas déjà fait.
Un grand merci à la Masse critique de Babelio et aux éditions Belfond.
L'auteur :
Yûsuke Kishi est né le 3 janvier 1959 à Osaka. Il a publié une dizaine de romans dont La leçon du mal.
La guerre n'est pas finie (Là où fleurissent les cendres)
Après le somptueux Pour que chantent les montagnes, Nguyen Phan Qué Mai est loin d'en avoir fini avec l'histoire tumultueuse de son pays d'origine. Et la guerre au Vietnam n'est pas terminée, plus de 50 ans après, pour les combattants américains survivants et surtout pour les habitants du Vietnam qui l'ont vécue dans leur chair, sans oublier les enfants métissés, ces Amérasiens qui vivent l'ostracisme et le mépris depuis leur naissance. L'autrice avait du grain à moudre et une documentation importante, parfois des témoignages directs, à sa disposition. Restait à y joindre un souffle romanesque et, sur cet aspect-là, la romancière ne manque pas d'inspiration, loin s'en faut, comme le montre Là où fleurissent les cendres, bâti avec beaucoup de virtuosité autour de plusieurs personnages forts, chacun emblématique d'une situation douloureuse (la jeune femme qui fréquente les bars à soldats en 1969 et que son amant abandonne, le militaire américain qui revient sur ses traces, bien des années plus tard, après avoir abandonné la mère de son enfant, l'Amérasien qui cherche désespérément son géniteur). Nguyen Phan Qué Mai joue parfaitement avec les temporalités, scrute les dilemmes moraux et maîtrise les rebondissements, jusqu'au dénouement. Avec une, ou plutôt des histoires pareilles, le livre est évidemment souvent bouleversant mais il dépasse parfois la limite (impression évidemment subjective), dans la recherche de l'émotion à tout prix, qui signifie parfois se départir d'une certaine pudeur. Chagrin, pardon, regrets, résistance : les ingrédients du roman sont suffisamment puissants et les faits poignants pour ne pas nécessiter un degré de plus vers un sentimentalisme trop prononcé.
L'auteure :
Nguyen Phan Qué Mai est née en 1973 au Vietnam. Elle a publié 12 livres dont Pour que chantent les montagnes.