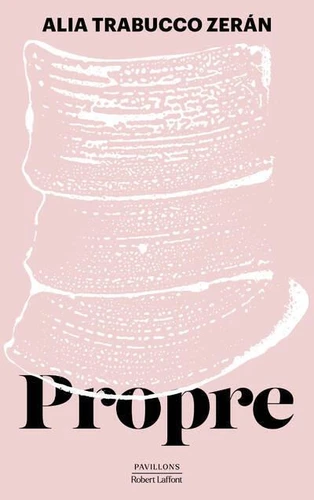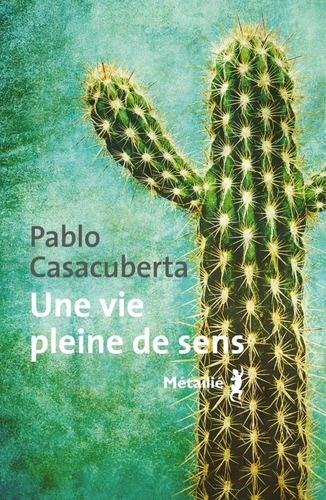Amérique du Sud
Phénotype du Brésil (La couleur sous la peau)
La couleur sous la peau de Paulo Scott est un livre hybride, un brin frustrant parce qu'il se termine trop vite mais passionnant aussi car il explore la complexité de la société brésilienne, sous le prisme du phénotype. Deux récits se complètent : d’une part, celui d'une famille confrontée au racisme, avec deux frères issus d'une famille noire, qui ne ressemblent pas, l'un pouvant passer pour un blanc, l'autre non ; et, d'autre part, celui, plus didactique, d'une commission gouvernementale chargée de plancher sur un programme informatique pour la sélection « objective » d’étudiants noirs, métis et indigènes, dans le cadre des quotas raciaux des universités publiques. L'auteur y ajoute des flashbacks concernant l'enfance du personnage principal, au temps de la dictature militaire, à Porto Alegre, ville qui est aussi un élément essentiel du roman. C'est aussi, à un degré moindre, un thriller et une histoire sentimentale, mais l'on retient avant tout le thème de la hiérarchie raciale au Brésil avec les préjugés et les injustices qui subsistent, dépendant fortement de la coloration de la peau. La fin du roman n'est pas celle du livre, puisque Paulo Scott poursuit avec une nouvelle qui s'inscrit plus avant dans le temps. De quoi nourrir sa propre réflexion sur le caractère du Brésil, ses inégalités et son héritage des temps de sa colonisation et de l'esclavagisme.
L'auteur :
Paulo Scott est né le 8 décembre 1966 à Porto Alegre (Brésil). Il a publié 8 livres.
Un pays sans mer (Séoul, São Paulo)
En 1884, après sa défaite dans la guerre du Pacifique contre le Chili, la Bolivie a perdu son accès à la mer. Séoul, São Paulo, le premier roman de Gabriel Mamani Magne, n'en raconte pas l'histoire mais le territoire cédé reste comme un membre amputé dont tous les Boliviens ont la nostalgie et qui nourrit l'animosité envers les Chiliens. A côté de La Paz, la capitale, se situe El Alto, au nom évocateur car la ville culmine à 4 000 mètres de haut et c'est là, dans cette cité, que vivent Tayson, récemment arrivé du Brésil où il a vécu jusqu'à ses 16 ans, et son cousin, le narrateur et véritable personnage central du livre, contrairement à ce que son titre semblait indiquer (Séoul fait référence à la K-pop dont Tayson est amateur). Récit d'apprentissage, le roman nous narre les (més)aventures des deux anti-héros, en particulier le curieux pré-service militaire, véritable laboratoire du machisme, mais aussi les préoccupations classiques d'adolescents tels que le sexe, les études (ratées), le football, l'alcool et la drogue. L'émancipation est difficile dans un pays aussi étroit quand on est confronté à la pauvreté et à un avenir morose qui passera sans doute par l'exil. Dans un style très direct et ironique, Séoul, São Paulo se révèle attachant même si l'ensemble manque un peu d'épaisseur.
L'auteur :
Gabriel Mamani Magne est né le 27 octobre 1987 à La Paz. Il a publié 3 livres.
Diorama familial (Au pays du dieu animal)
Cecilia Matzenbacher travaille dans la réalisation de dioramas, aux États-Unis, en tant que taxidermiste. C'est une femme attachante, un peu irrésolue quant à son avenir : elle aime son compagnon musicien mais ne désire pas d'enfant et elle est attirée par une autre femme. Mais c'est surtout son passé qui la déstabilise, elle, la brésilienne émigrée, marquée par un crime à Porto Alegre, 30 ans plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une enfant et dans lequel son père, député, a été impliqué, d'une manière ou d'une autre. Au pays du dieu animal, le roman de Carol Bensimon, bien meilleur, soit dit en passant, que son précédent, On adorait les cowboys, se déroule sur deux temporalités, avec une belle fluidité d'écriture pour relier les deux époques. C'est celle de la fin des années 80 au Brésil qui retient d'abord l'attention. Non seulement à cause du mystère du fait divers qui occupe une large part du roman mais aussi par l'évocation d'une période trouble, dans une démocratie hésitante, après des années de dictature. Le livre est aussi une sorte de diorama familial, autour de Cecilia, avec un père énigmatique, une mère qui ronge son frein et deux frères dont l'un se rend compte que ses préférences sexuelles vont être difficiles à assumer, dans un monde qui n'accepte pas les différences. A l'image de certains films brésiliens, ceux de Walter Salles et de Kleber Mendonça Filho, par exemple, c'est un pays tourmenté et patriarcal qui apparaît, lesté de tabous et de secrets, et néanmoins nostalgique de son passé. L'héroïne du roman reviendra t-elle sur les traces de son enfance, trois décennies plus tard ? La réponse figure dans les dernières pages de Au pays du dieu animal.
L'auteure :
Carol Bensimon est née le 22 août 1982 à Porto Alegre (Brésil). Elle a publié 5 livres dont On adorait les cowboys.
Cérémonies magiques (La main qui guérit)
La main qui guérit est une histoire de transmission familiale, de mère à fille, plus précisément, mais qui ne pourra se faire que dans la douleur et suivant des rituels bien précis. Le roman se situe dans la lignée de nombreux livres latino-américains mais là où une grande majorité d'entre eux utilisent le surnaturel pour enrichir l'intrigue de moments magiques, le récit de la Colombienne Lina María Parra Ochoa se complaît dans de très longues pages de descriptions, censées nous envoûter, mais qui, par leur répétition, finissent par lasser en nous éloignant de la psychologie de ses deux personnages principaux et de leur relation. Le style est fluide, cependant, et certains passages fascinent, ceux de l'apprentissage de la mère, qui est encore une jeune femme, et de sa fille, des années plus tard, comme un copier-coller de sensations et d'hésitations pour s'approprier, chacune à leur tour, des sortilèges, disons-le, de sorcières. Invisibilité, contact avec les défunts, capacité à voir l'avenir, autant de pouvoirs que ces deux femmes, avec l'aide d'une troisième, leur mentor commun, ne peuvent acquérir que flanqués d'un versant noir, d'un danger extrême. Voici un roman qu'on aurait pu et dû aimer davantage mais qui est quelque peu étouffé par sa propension à abuser de situations et de cérémonials magiques.
L'auteure :
Lina María Parra Ochoa est née à Medellín (Colombie). Elle a publié plusieurs nouvelles.
Journal d'après apocalypse (Les Indignes)
Dans la plupart des récits post-apocalyptiques, l'errance du ou des personnages principaux compose une grande partie de l'intrigue, avec le danger qu'elle charrie, dans un monde soumis au chaos et où la survie tient lieu de préoccupation quotidienne. Dans Les Indignes, d'Agustina Bazterrica, il y a bien une histoire de fuite éperdue mais celle-ci n'intervient qu'en flash-back, après que la lumière du monde s'est éteinte. La majeure partie du livre se situe dans une sorte de couvent où une hiérarchie sociale s'est imposée, au nom d'une nouvelle religion et où les brimades et les sévices ne cessent jamais. Ce huis-clos oppressant, décrit dans le journal clandestin d'une "Indigne", avec ses rites étranges, commence dans une certaine opacité, avant qu'une nouvelle arrivante ne vienne semer un certain désordre et peut-être la révolte. Les écrivaines latino-américaines sont de plus en plus nombreuses à imposer leur univers, à travers des dystopies, des romans gothiques et d'horreur, refusant les tabous et s'autorisant la cruauté et la perversité de récits glaçants, loin de toute zone de confort, qui interrogent aussi bien la férocité de l'âme humaine que notre propension à épuiser les ressources de la planète. Les Indignes (au même titre que Cadavres exquis de la même Agustina Bazterrica) n'atteint pas l'intensité d'une Mariana Enriquez, d'une Karina Sainz Borgo ou d'une Fernanda Trías, par exemple, mais le livre, dont l'intérêt va crescendo, a de quoi impressionner de par sa puissance d'évocation et son inéluctabilité tragique.
L'auteure :
Agustina Bazterrica est née en 1974 à Buenos Aires. Elle a publié 4 livres dont Cadavres exquis.
Dans un village opaque (Tu as amené avec toi le vent)
S'il est vrai que Mortepeau, le premier roman de l’Équatorienne Natalia García Freire, entretenait un certain flou sur les événements décrits, passés ou présents, celui-ci ne prenait jamais le pas sur l'atmosphère générale, propre à susciter une véritable fascination. Dans Tu as amené avec toi le vent, le flou devient opaque et bien malin qui pourrait dire ce qu'il se passe réellement dans ce livre, situé dans un village pré-andin, puis au sein d'une nature étouffante où vivants et morts s'affrontent (ou peut-être pas). Il serait trop tentant de parler de réalisme magique, désormais devenu un déchiffrement un peu trop convenu d'une part de la littérature d'Amérique latine, mais c'est insuffisant. La romancière possède un style très personnel, flamboyant dans le grotesque et dans le sordide, le tout au service d'une vision très noire des errements, parlons même de folie, des humains, face à une nature loin d'être innocente. Il est hélas aisé de décrocher du livre définitivement, bien avant sa moitié, même si quelques scènes extravagantes retiennent l'attention alors qu'un humour, forcément sombre, s'invite parfois dans ce conte cruel aux contours fuligineux.
L'auteure :
Natalia García Freire est née en 1991 à Cuenca (Equateur). Elle a publié Mortepeau.
Une fillette va mourir (Propre)
Un roman qui n'est que monologue pose toujours la question de la crédibilité des faits énoncés, à partir du moment où, par définition, aucun autre point de vue n'est exposé. C'est la loi du genre et c'est au lecteur de décider s'il doit absolument faire confiance à la narratrice, Estela, en l'occurrence, dans le livre d'Alia Trabucco Zerán. Cette histoire aurait pu s'intituler La nana (La bonne), mais il y aurait eu confusion avec un excellent film de 2009, Chilien lui-aussi, qui porte ce titre. D'emblée, à la manière de Leïla Slimani dans Chanson douce, l'autrice annonce l'épilogue : la fillette de la maison dont s'occupe Estela va mourir. Comment ? Nous ne le saurons qu'à la fin, assassinat ou non, mais le suspense n'est qu'un prétexte pour assister au quotidien de l'employée de maison, ses rapports avec ses patrons, pour lesquels elle est quasi invisible et vaguement méprisée, même si son travail est bien fait. Par ailleurs, se pose la question de l'aliénation d'Estela, en termes de santé mentale, plus le roman progresse vers sa conclusion. Question subsidiaire : est-ce que celle-ci s'adresse à nous depuis une prison ou bien d'un asile ? Si c'est la deuxième option, il y encore plus à douter de la version qui nous est contée et c'est toute la perversité madrée d'Alia Trabucco Zerán que de laisser infuser le malaise, dans un récit assez bien mené dans sa première partie mais qui s'enlise quelque peu dans sa deuxième, le message de l'esclavage de plus en plus mal consenti par Estela, étant bien compris, et assez vite, avec l'humiliation qui va avec. Ne parlons pas de remplissage pour la dernière moitié du livre mais de délayage, peut-être, avec un dénouement un peu flou.
L'auteure :
Alia Trabucco Zerán est née le 26 août 1983 à Santago du Chili. Elle a publié La Soustraction.
Une femme insaisissable (La petite sœur)
C'est le succès, très mérité, des livres de Mariana Enriquez qui a sans doute incité les éditions du sous-sol à faire paraître la traduction du portrait de la grande et méconnue femme de lettres argentine Silvana Ocampo, 10 ans après la première parution de l'ouvrage en espagnol. Portrait et non biographie, tient à souligner Mariana Enriquez, tant son sujet, autrice de poésie et de nouvelles, entre autres, reste un être insaisissable, bien après sa mort, en dépit des nombreux témoignages recueillis et qui ont pour principale caractéristique d'être contradictoires. Silvana Ocampo était une bourgeoise excentrique dont les écrits reflètent une imagination perverse, dans une œuvre que l'on peut qualifier de bizarre, faute de mieux, ce qui en fait effectivement "la petite sœur" de Mariana Enriquez en écriture, à l'aune des livres horrifiques publiés par cette dernière, dont le désormais célèbre Notre part de nuit. Dans la vie de Silvana Ocampo, racontée sous forme de puzzle, plusieurs figures littéraires célèbres l'ont dissimulé au public, et aujourd'hui encore, ce qui au fond l'arrangeait bien. A commencer par son mari, Alfonso Bioy Casares, lequel la trompait copieusement, sans pour autant envisager de cesser de l'aimer ni de la quitter. Son ami, Jorge Luis Borges, a aussi fait partie des intimes de Silvana et de la sœur aînée de celle-ci, la très brillante Victoria Ocampo. Les relations entre Victoria et Silvana furent compliquées et souvent hostiles et constituent l'un des intérêts majeurs de ce livre, très riche en anecdotes et en témoignages, d'époque ou recueillies directement par Mariana Enriquez. En fin de compte, cette passionnante étude réussit parfaitement dans son entreprise qui est de nous donner envie de nous ruer sur les livres de Silvana Ocampo, écrivaine anti-conformiste et visiblement encore sous-évaluée.
L'auteure :
Mariana Enriquez est née le 6 décembre 1973 à Buenos Aires. Elle a publié 9 livres dont Notre part de nuit et Les dangers de fumer au lit.
Le crépuscule des vieux (Eufrasia Vela et les sept mercenaires)
Inutile de tourner autour du déambulateur, le sujet de Eufrasia Vela et les sept mercenaires (le titre original du livre en espagnol étant Cent cochons d'Inde) est bien celui de l'euthanasie. Il s'agit du deuxième roman traduit en français de l'écrivain péruvien Gustavo Rodriguez, après l'excellent Les matins de Lima. Construit selon une progression limpide, le livre, par son ton et ses situations, pourrait aisément se comparer à certaines comédies sociales du cinéma britannique, qui s'attaquent à des thèmes a priori lourds, transfigurés par l'humour, la tendresse et la plus profonde des humanités. De sa plume incisive, l'auteur raconte le crépuscule des vieux, leur appel à finir dans la dignité et, face à eux, le dévouement et l'empathie de leur aide-soignante, Eufrasia Vela. C'est aussi le livre du Pérou d'aujourd'hui, des inégalités sociales et des transformations d'un pays où l'accès à la mer semble de plus en réservé aux plus riches et aux bien-portants. Quelle que soit sa propre opinion vis-à-vis de la fin de vie, le roman de Gustavo Rodriguez suscite une jolie émotion mais sans que l'auteur ne se croit obligé de traquer nos glandes lacrymales. Il évite consciencieusement les effets mélodramatiques en "coupant" très vite les scènes qui, autrement, auraient pu tomber dans une sorte de voyeurisme morbide. Un livre léger sur un thème qui ne l'est pas et soumis à des questionnements qui se posent à n'importe quel humain, à un moment de son existence, pour son propre compte ou pour ses proches. Une leçon de vie, et de mort, en quelque sorte, empli à part égale de joie et de tristesse, qui n'a surtout pas la prétention de s'ériger en jugement (a)moral.
L'auteur :
Gustavo Rodriguez est né en 1968 à Lima. Il a publié 7 romans dont Les matins de Lima.
Perdre est une question de méthode (Une vie pleine de sens)
Perdre est une question de méthode, proclamait il y a quelques années le titre d'un excellent roman du Colombien Santiago Gamboa. David, le narrateur et anti-héros d'Une vie pleine de sens, semble aussi détenir les clés pour se compliquer l'existence, s'attirer des inimitiés et pour parler vulgairement, foirer sa vie, professionnelle et familiale, dans un même élan apathique, si l'on ose cet oxymore. Le cheminement du susdit est tragiquement drôle, dans une certaine tradition d'humour juif, mais le livre ne fait pas tellement rire, tellement son personnage principal fait de la peine, dans sa maladresse innée et ses difficultés à comprendre le monde qui l'entoure. Cet homme est un chercheur, ce qui vaut au lecteur un grand nombre de descriptions scientifique, lesquelles il faut bien le dire, auraient mérité d'être raccourcies. A l'inverse, quand l'auteur se fait plus concret que théorique et évoque les soucis familiaux de David, ses rapports exécrables avec son beau-père, désastreux avec son épouse et frustrants avec son fils, on peut apprécier à sa juste valeur le style de Pablo Casacuberta, élégant et racé, à peine alourdi par une multitude de métaphores. Le roman est inégal, donc, avec quelques passages abscons, mais l'auteur uruguayen possède une dose d'ironie considérable qui rend son livre appréciable, en définitive, même si l'on ne peut pas dire qu'il fait beaucoup pour nous permettre de comprendre et encore moins d'aimer ce malheureux David.
Un grand merci aux éditions Métailié et à NetGalley
L'auteur :
Pablo Casacuberta est né en 1969 à Montevideo. Il a publié 5 romans dont Ici et maintenant et Une santé de fer.