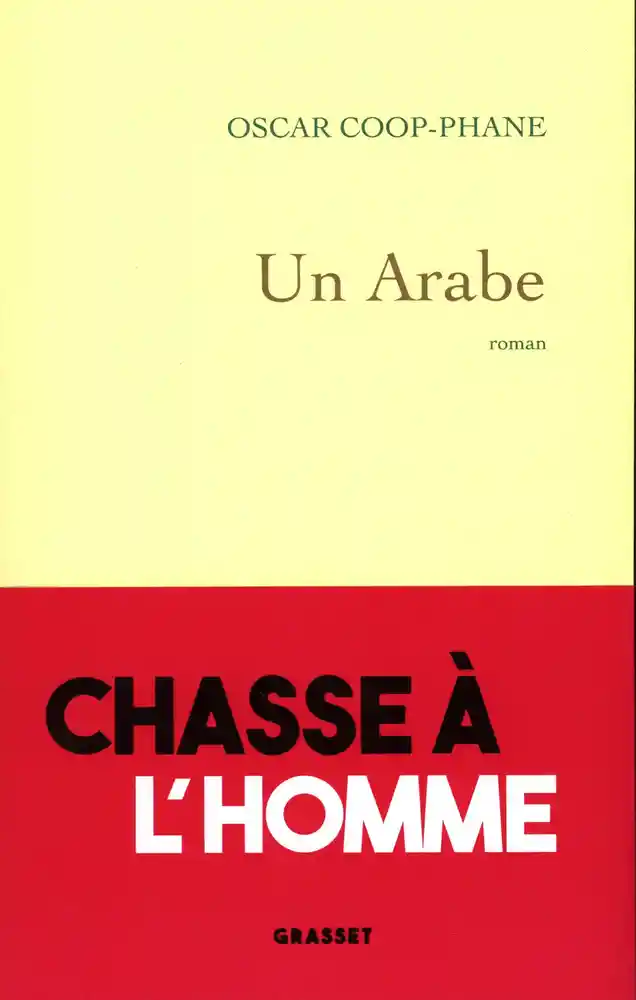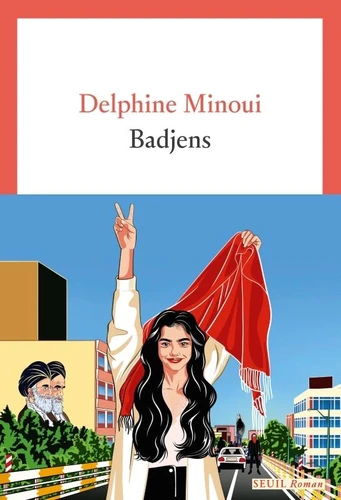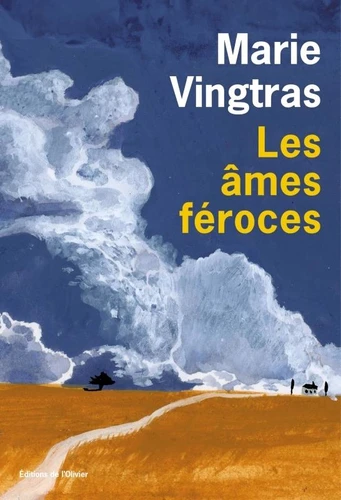France
Il vous salue Marie (Entre toutes)
Franck Bouysse vous salue Marie et vous magnifie, sans nul doute, dans une ode romancée à votre tempérament et à votre courage, dans une ferme corrézienne, au siècle dernier. Marie, c'est la grand-mère de l'auteur, née en 1912, peu avant cette abominable boucherie que l'on nomme Première Guerre mondiale. C'est un roman, bien sûr, mais nourri de ce que l'écrivain sait de la vie de cette femme et surtout des tourments qu'elle connut, et même, peut-on parler de tragédie, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale. Bouysse décrit les travaux des champs, ceux d'un temps désormais révolu, s'arrogeant parfois la licence de commenter l'évolution inéluctable d'un progrès qui éloigne peu à peu du respect de la nature et de ses cycles. Mais il en revient toujours à Marie, avec une part presque égale dédiée à la mère de celle-ci, Anna, inséparables et tour à tour seules ou presque à pérenniser la ferme familiale. Elles deviennent, à un moment de leurs histoires respectives, des femmes libres, non par choix, mais à cause des circonstances dramatiques qui les ont accompagnées et leur face-à-face avec Dieu se nuance de bien des manières. La langue de l'auteur fouille l'intime avec une infinie pudeur, s'autorisant quelques embardées lyriques et, vraisemblablement, des interprétations toutes personnelles, toujours dans le respect de la mémoire de Marie et d'Anna. Cet hommage posthume touche directement au cœur et parle à tous, non comme un éloge funèbre, mais comme une élégie qui possède aussi ses moments de joie et de plénitude. Rien que des vies au plus proche de la terre, celles d'héroïnes qui, comme beaucoup d'autres, ne se seraient jamais jugées comme telles, se contentant de mener leur barque à bon port, avec humilité et dignité, malgré les tempêtes et sans regrets, une fois leur temps écoulé.
L'auteur :
Franck Bouysse est né le 5 septembre 1965 à Brive. Il a publié 18 livres dont Né d'aucune femme et Buveurs de vent.
Le temps des inséparables (Et toute la vie devant nous)
Comme presque toujours, on entre de plain-pied dans le dernier roman d'Olivier Adam avec l'impression que son intrigue va en dire autant sur nous que sur lui, l'homme et l'écrivain. Dans le trio qu'il met en scène dans Et toute la vie devant nous, l'un d'entre eux est à l'évidence un double du romancier, et Adam ne s'épargne pas beaucoup, à travers son personnage frappé du syndrome de l'imposteur et accusé par ses proches de nourrir sa prose de la vie des autres, comme un vulgaire vampire. Ce n'est là qu'un des aspects d'un livre qui engage émotionnellement très vite avec ses deux gars, une fille, inséparables depuis leurs jeunes années. Le récit commence 40 ans en arrière, dans cette périphérie parisienne si souvent décrite par l'auteur et remonte progressivement le temps, jusqu'à nos jours. Seuls deux des trois protagonistes s'expriment, à tour de rôle, mais le troisième larron, personnalité inflammable, est on ne peut plus présent, avec ses failles et ses mystères. La nostalgie est plus que jamais ce qu'elle a été et pour ce trio, une partie de leur existence future se joue dès l'adolescence, avec un accident dramatique qui les soude à jamais. D'autres secrets, individuels, ceux-là, se révèleront, au fil des jours, entamant l'harmonie de ce triangle aux contours amoureux. Au-delà de la perte des illusions, des échecs professionnels et des déboires sentimentaux, c'est un vibrant hymne à l'amitié qu'a écrit Olivier Adam, dans un livre dans lequel il reprend nombre de ses motifs familiers, mais comme réinventés ou réorchestrés dans un style simple et fluide qui constitue sa marque. Certains passages illustrent sans doute trop lourdement ce que le romancier pense des mœurs de notre époque actuelle et de ses dérives, de même qu'il sème beaucoup de noms d'artistes pour délimiter les différents temps qu'il fait traverser à ses héros, mais c'est un reproche mineur, devant le flux absorbant de sa narration et de l'immense empathie qu'il inspire vis-à-vis de ses personnages ballottés par la vie et ses aléas.
L'auteur :
Olivier Adam est né le 12 juillet 1974 à Paris. Il a publié 19 livres dont Falaises, Des vents contraires et Tout peut s'oublier.
L'ivresse du pouvoir (La guerre par d'autres moyens)
"Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou" écrivait John Emerich Dalberg. Dans La guerre par d'autres moyens, deux personnages en sont l'illustration : un président de la République déchu, qui sombre dans l'alcoolisme, et un réalisateur de cinéma qui entend dénoncer les violences faites aux femmes et y succombe dans sa vie privée. Autour d'eux, dans le roman de Karine Tuil, un certain nombre de femmes se débattent, souvent malheureuses, mais combatives. La romancière vise à capter l'air du temps, en racontant, une fois de plus, les "choses humaines", comme elle l'a fait, plutôt brillamment, dans ses récits précédents. La guerre par d'autres moyens pêche par accumulation, multipliant les personnages et les situations, évoquant pêle-mêle les réseaux sociaux, l'antisémitisme, les couples avec différence d'âge (dans un seul sens), le handicap, etc. Roman total d'une époque déboussolée, le livre se lit comme un feuilleton avec des intrigues savamment tissées pour aller crescendo et il est difficile de ne pas être emporté par sa puissance. Même s'il y a des réticences, les personnages ne sont-ils pas stéréotypés et les mœurs des milieux portraiturés, la politique et le cinéma, entre autres, ne sont-ils pas porteurs de clichés ? Certainement, oui, mais toute caricature et chaque cliché ne convoient-ils pas une grande part de vérité ? C'est cette volonté de l'auteure de parler de tous les sujets qui l'expose à ne les survoler que à plus ou moins gros traits. Une exception tout de même : l'alcoolisme, dont les effets de manque et de destruction sont décrits avec acuité, sans dépasser la mesure. La guerre par d'autres moyens peut irriter par ses trop-pleins mais, au fond, Karine Tuil n'a t-elle pas, elle aussi, cédé à l'ivresse du pouvoir, celui d'entraîner dans son sillage des milliers de lecteurs et de lectrices, par la seule entremise des mots ?
L'auteure :
Karine Tuil est née le 3 mai 1972 à Paris. Elle a publié 14 livres dont L'invention de nos vies, Les choses humaines et La Décision.
Troisième génération (J'emporterai le feu)
Troisième round de la trilogie marocaine de Leïla Slimani, J'emporterai le feu diffère assez des deux premiers volumes car moins marqué par "l'exotisme" d'un temps plus lointain, dans un Maroc qui a bien changé depuis un siècle. Pas de regrets à avoir, l'on sent bien que ce tome est le plus proche de l'autrice, que l'on retrouve, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, dans le personnage de Mia, en quête d'identité et de liberté. C'est elle qui prend la plus grande part de lumière dans le livre, la partageant avec sa sœur Inès, dans un apprentissage de la vie loin d'être indolore. Ce sont deux portraits de jeunes femmes, connectées à leurs mère, grand-mère et tante, une génération confrontée à l'exil de leur pays natal mais aussi aux grands événements et à la cruauté d'un monde qui semble se chercher un avenir pareillement, parfois dans la violence. La plume aiguisée de Leïla Slimani raconte des destins modernes qui se heurtent à l'intolérance et au conservatisme dans un récit vibrant, politique parfois, mais qui joue la carte du romanesque avec une grande dextérité. Un roman familial et intime qui résonne plus large, plein de tendresse pour ses protagonistes (notons les belles pages consacrées au père des deux héroïnes) mais aussi cruel à l'occasion. Il n'y a rien de moins lisse qu'un livre de Leïla Slimani, dont personne n'a oublié qu'elle a écrit Chanson douce.
L'auteure :
Leïla Slimani est née le 3 octobre 1981 à Rabat. Elle a publié 5 romans dont Dans le jadin de l'ogre et Chanson douce.
Effluves d'une époque (Un avenir radieux)
Ils sont tous là, à nouveau, et c'est du nanan. Cela semble si facile, sous la plume ciselée de Pierre Lemaitre, de raconter les effluves d'une époque, promise à Un avenir radieux, notez bien l'ironie, car les orages ne sont jamais loin. Et cela concerne la marche du monde, avec le rideau de fer, qui permet à l'auteur de s'attaquer au roman d'espionnage, mais avec l'humain en première ligne, façon Le Carré, en moins complexe, tout de même. Ils sont tous là, les personnages rencontrés dans les deux opus précédents, y compris ceux que l'on aime à détester, comme cette abominable Geneviève. L'air de rien, Lemaitre brasse une multitude de thèmes, de l'agriculture intensive aux enfants maltraités, tout en nous plongeant dans la rédaction d'un grand quotidien ou dans les coulisses de la radio, celle qui se met à l'écoute de ses auditeurs. Balzacien, Un avenir radieux ? Sans aucun doute, avec aussi ce goût du feuilleton à l'ancienne, mélangeant les destinées, orchestrant les coups de théâtre, ménageant le suspense, avec une description psychologique de chacun des protagonistes d'une maîtrise imparable. Il n'est pas nécessaire de raconter en détail les tourments, les drames et les épiphanies des différents protagonistes d'Un avenir radieux. L'on se lance dans le livre avec la certitude de passer un moment rare de plaisir jusqu'à l'inévitable pincement au cœur quand la saga s'achève car l'on aurait bien continué encore longtemps à suivre cette chère famille Pelletier. Ce sera pour le prochain ouvrage et le compte à rebours a déjà commencé.
L'auteur :
Pierre Lemaitre est né le 19 avril 1951 à Paris. Il a publié 15 livres dont Au revoir là-haut, Le grand monde et Le silence et la colère.
Un scénario détraqué (Bristol)
Echenoz est de retour et c'est une bénédiction autant qu'un délice, forcément. Dans Bristol, l'intrigue n'a qu'une importance relative, mettant en avant un réalisateur de cinéma sans talent aucun, adaptant un roman à l'eau de rose, pour un tournage épique au cœur du Botswana. Dans un enchaînement irrésistible de situations souvent incongrues et au milieu de personnages excentriques, l'auteur développe son sens de l'absurde avec son habituelle maîtrise, multipliant les clins d’œil au lecteur complice et énonçant parfois ses propres réflexions acerbes sur la toile narrative qu'il a lui-même tissé. Dans Bristol, un homme se défenestre, une ancienne actrice multiplie les amants, un éléphant détruit un village de brousse, etc, dans une sorte de scénario détraqué et jouissif où tout peut arriver, surtout si c'est inattendu. Echenoz s'amuse avec les mots, avec élégance et un brin de pédanterie malicieuse, emplafonne le réalisme, dézingue l'esprit de sérieux et retombe sur ses pieds, après avoir joué au funambule. Il s'est bien amusé, suppose t-on, et nous aussi, par la même occasion, à condition d'apprécier son humour, pas très français, en définitive, mais nonsensique, à l'instar des Marx Brothers, par exemple.
L'auteur :
Jean Echenoz est né le 26 décembre 1947 à Orange. Il a publié 19 livres dont Je m'en vais, Au piano, 14 et Envoyée spéciale.
Devant la meute hurlante (Un Arabe)
Haletant, Un Arabe l'est assurément, mais ce n'est pas le suspense proprement dit qui intéresse l'auteur du roman, Oscar Coop-Phane, à partir du moment où le dénouement ne pourra être que tragique. Non, ce qui le fait raconter cette poursuite échevelée, c'est le pourquoi du drame, surtout, et le comment, accessoirement. Le livre, transposé aux États-Unis, deviendrait une traque raciste, organisée par le Ku Klux Klan, mais dans le sud de la France, de nos jours, les protagonistes de cette chasse à l'homme n'ont pas besoin de cagoules, ce sont des gens "ordinaires", victimes de leurs préjugés et d'une colère enfouie en eux, parce qu'ils ont plus ou moins raté leur vie, qu'ils se sentent plus forts en groupe, dans une meute hurlante qui cherche l'hallali et l'alcool n'est pas suffisant pour expliquer ce comportement grégaire et haineux. En quelques phrases, l'auteur décortique chacune de ces existences médiocres, au risque parfois de tomber dans la caricature. Mais quand il montre comment ces individus, des hommes exclusivement, de faux mâles alpha, définitivement be(ê)ta, deviennent une horde qui ne réfléchit plus et se croit détentrice d'une justice immanente, la plume de l'écrivain se fait convaincante et symbolise tout ce qu'une foule aveugle et haineuse peut perpétrer, comme si la barbarie et le désir de lyncher n'étaient rien d'autre que la résurgence de pulsions de violence et de défoulement, comme une revanche sur l'ingratitude de la vie. Et qui mieux que "l'Autre", celui qui a le tort d'être différent et de venir d'ailleurs, pour jouer le rôle de suspect idéal, de bouc émissaire de toutes les rancœurs ingurgitées ? Que se passera t-il après le dénouement du livre ? Pas grand chose, évidemment, un fait divers, évoqué dans les journaux, avec une bande d'individus qui pourront se rejeter mutuellement la faute et dont les regrets ne seront, vraisemblablement, pas à la hauteur de cette espèce d'euphorie qu'ils ont ressentie, sûrs de leur bon droit et ivres de leurs instincts primaires.
Un grand merci à NetGalley et aux éditions Grasset.
L'auteur :
Oscar Coop-Phane est né le 15 décembre 1988 à Lyon. Il a publié 9 livres dont Le procès du cochon et Rose nuit.
Un caillou dans la chaussure (Frapper l'épopée)
Alice Zeniter n'a pas vécu en Nouvelle-Calédonie, elle y a séjourné à deux reprises et s'est beaucoup documentée sur le présent, tumultueux, de l'île, et sur son passé, qui ne l'est pas moins. Est-ce que cela lui donne le droit d'écrire sur le sujet ? Évidemment, oui, si l'on considère qu'il s'agit de sa vision à elle, alimentée à de nombreuses sources, et que c'est un roman, avant tout, même si l'autrice s'en extrait, au moins à une reprise, comme lorsqu'un film montre volontairement la caméra qui tourne. Cela dit, Frapper l'épopée est loin de valoir L'art de perdre mais reste un ouvrage agréable, quoique parfois déconcertant, avec ses deux intrigues qui se rejoignent et un point de basculement inattendu, où le surnaturel vient remplacer le réalisme. Cela dit (bis), le roman se fait aussi récit historique et ceux qui connaissent mal Le Caillou et son passé y apprendront un certain nombre de choses tout à fait passionnantes. Ce caillou dans la chaussure qu'est la Calédonie pour la France coloniale est portraituré avec toutes ses composantes, les Kanaks, ses habitants originels, en premier lieu. La plume vive d'Alice Zeniter fait passer le côté composite du livre, de même qu'un humour et une ironie assez emballants. Cela dit (ter), savoir comment le roman a été accueilli par les Calédoniens eux-mêmes est une question qui se pose forcément.
L'auteure :
Alice Zeniter est née le 7 septembre 1986 à Clamart. Elle a publié 8 romans dont L'art de perdre, Juste avant l'oubli et Comme un empire dans un empire.
Un cri pour la liberté (Badjens)
Le 18 septembre prochain, Les graines du figuier sauvage sortira dans toutes les bonne salles de cinéma, en France. Un film puissant et terrible, qui prend les grandes manifestations de 2022, en Iran, comme toile de fond pour décrire une famille divisée entre un père fidèle au pouvoir, ses filles rebelles, et une mère qui penche vers ces dernières, tout en essayant de maintenir la paix dans son ménage. Cette femme ressemble beaucoup à celle de Zahra, l'adolescente de Badjens, dont on suit le parcours depuis sa naissance et jusqu'aux événements évoqués plus haut, lesquels n'ont pas réussi, hélas, à faire chuter le régime des mollahs. Nourri par ses contacts avec de jeunes iraniennes, le livre de Delphine Minoui va à l'essentiel pour brosser un portrait accablant d'un pays où une génération entière s'est révoltée, aux cris de "Femme, Vie, Liberté." Le tableau de la condition féminine en Iran a beau être connu, l'autrice lui donne une grande vérité et acuité dans un texte rageur, au style concis et rythmé, fait de phrases courtes et tranchantes. De nos jours, les livres voyagent vite et nul doute que Badjens contribuera, à sa manière, à ce que la lutte continue contre l'ignominie.
L'auteure :
Delphine Minoui est née en 1974, en France. Elle a publié 8 livres.
Il ne se passe jamais rien ici (Les âmes féroces)
Marie Vingtras n'est pas la première à être fascinée par le mode de vie américain, notamment dans une petite ville un peu morne "où il ne se passe jamais rien", sauf, qu'évidemment, un drame advient dès les premières pages de Les âmes féroces. Si enquête policière il y a, avec révélation du (de la ?) coupable du meurtre d'une adolescente, c'est l'atmosphère qui intéresse au premier chef la romancière, ainsi que le portrait psychologique de plusieurs habitants de la localité. Et si tout cela s'était passé dans le Lot ou dans les Vosges, est-ce que cela aurait changé quelque chose au ton du livre et à son déroulement ? Un peu sans doute, mais pas en profondeur, puisqu'ailleurs ou ici, les âmes sont tout aussi féroces, dans une communauté où tout le monde, ou presque, se connaît, et a une opinion sur ses voisins, plus ou moins éloignés. A défaut de faire montre d'un style éblouissant, Marie Vingtras possède un savoir-faire évident pour faire monter la pression, distiller des informations nouvelles au fur et à mesure et ménager le suspense. Elle a construit habilement son récit entre 4 parties, comme autant de saisons, avec des narrateurs différents, qui font avancer l'intrigue, grâce ç une belle maîtrise des couches temporelles, sans que jamais le procédé ne paraisse lourd ou systématique. Chacun ou chacune aura sans doute un témoignage "préféré", le troisième, celui de la meilleure amie de la victime, étant peut-être le plus marquant. En se servant de stéréotypes, mais en les accommodant pour les rendre originaux, voire atypiques, l'autrice réussit à nous tenir en haleine, tout en épinglant, non sans bienveillance,et avec justesse, tout ce qui caractérise notre (in)humanité.
L'auteure :
Marie Vingtras est née en 1972 à Rennes. Elle a publié Blizzard.