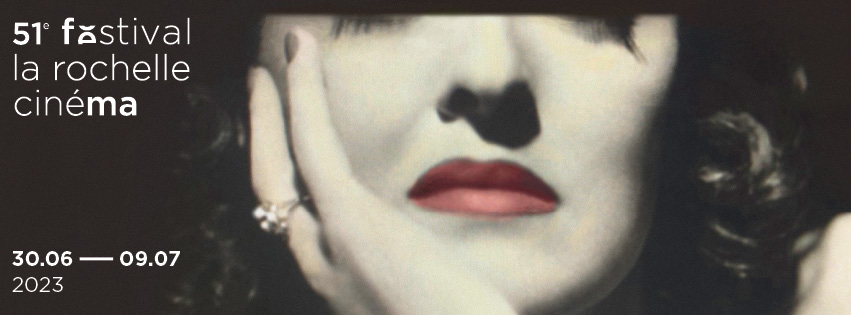Rochelle que j'aime (7)
Les naufragés de l'île de la tortue de Jacques Rozier, 1976
Qu'est-ce qui marque quand on revoit pour la première fois Les naufragés de l'île de la tortue, qui plus est sur un grand écran de cinéma, dans une salle bondée et acquise au film (festival de La Rochelle 2023) ? En premier lieu, la liberté de ton de son réalisateur, Jacques Rozier, dans une comédie qui ressemble parfois à un essai expérimental. Avec ses moments jubilatoires mais aussi ses très longs creux qui envahissent un film de près de 2 heures et 20 minutes. La déception vient principalement d'un manque d'approfondissement certain des personnages, y compris les deux principaux, qui passent toujours après des situations absurdes et des bribes de dialogues parfois très amusants, quand même. Plus que Pierre Richard, assez contraint, c'est du côté de Jacques Villeret et de quelques seconds rôles croustillants (Patrick Chesnais, Jran-François Balmer) que l'on ira chercher des motifs de satisfaction dans cette épopée hardie et pathétique à la fois. Après cela, c'est le tournage du tournage que l'on aimerait bien découvrir, qui serait sans doute encore plus drôle et plus baroque que le film lui-même.
La fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora
Avec La fleur de Buriti, on ne peut qu'être touché par le message de dignité de la communauté krahô au Brésil, peuple indigène spolié et massacré de tous temps. Dans leur nouveau long-métrage, João Salaviza et Renée Nader Messora, les coréalisateurs qui forment un couple dans la vie, ont opté pour une forme hybride (très à la mode en ce moment), à savoir la fiction alimentée par la réalité, que l'on a le droit de trouver moins pertinente que le documentaire pur et dur, et d'une certaine façon presque gênant car s'appuyant sur une émotion quelque peu forcée. Néanmoins, La fleur de Buriti lorsqu'il se fait honnêtement ethnographique et moins revendicateur se révèle passionnant, eu égard à la philosophie de vie de ces autochtones, auxquels les notions de profit et d'exploitation des richesses de la nature sont totalement étrangères. L'aspect politique, en pleine période Bolsonaro, est bien évidemment abordé avec force mais ce n'est paradoxalement pas là que se situe le caractère le plus captivant du film. Depuis le tournage, Lula a été élu président et Sônia Guajajara, que l'on aperçoit en tant que militante dans La fleur de Buriti, est désormais à la tête du ministère des Peuples autochtones. Une grande avancée pour ces Amérindiens du Brésil maltraités et étouffés depuis trop longtemps.
Quand les vagues se retirent de Lav Diaz
3 heures et 7 minutes seulement pour Quand les vagues se retirent, c'est presque l'équivalent d'un court-métrage pour Lav Diaz, habitué à des durées bien supérieures. Pas de surprises cependant, il y a toujours des scènes qui s'éternisent chez le cinéaste philippin et dont a du mal à comprendre la raison de l'insistance. A part cela, Quand les vagues se retirent est sans doute l'un de ses films parmi les plus lisibles et souvent captivants, sans doute parce qu'il lui a donné la forme d'un thriller, à combustion lente, certes, mais dont on attend à raison une résolution explosive. Entre temps, le récit suit ses deux protagonistes principaux en parallèle, deux policiers qui ne sont plus en fonction pour des raisons différentes, l'un d'eux souffrant d'une maladie de peau, symptomatique du système philippin gangrené par la corruption et la violence endémique. Lav Diaz n'est pas tendre pour le pouvoir dans son pays et sa force de frappe (militaire et policière), qui semble au-dessus des lois. Réalisé en noir et blanc, le film est d'un esthétisme renversant, notamment dans ses nombreuses scènes nocturnes, et se caractérise par une maîtrise singulière de l'absurde, accompagnée parfois d'un humour féroce et inattendu. Tout ceci fait de Quand les vagues se retirent un objet vraiment digne d'intérêt, même pour les plus réfractaires au style du cinéaste.
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 51 autres membres